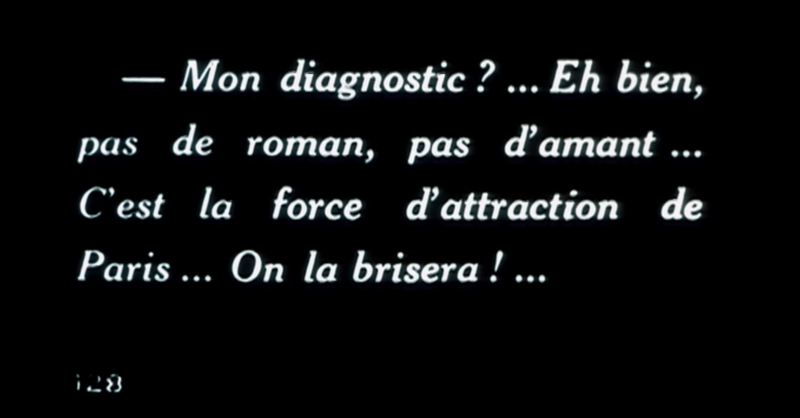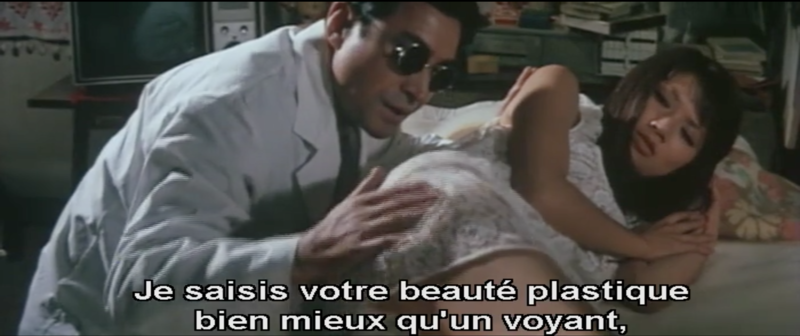Romance de bureau : le charme discret de la bureaucratie
Réalisateur : Eldar Riazanov
Pays : URSS
Année : 1977
Grand succès d’un réalisateur connu pour ses films très populaires et ses comédies entrainantes (on pense notamment à la très joyeuse Nuit du carnaval réalisée vingt ans auparavant), Romance de bureau continue de développer la même veine comique mais en y ajoutant un motif sentimental. On peut dès lors parler avec ce film de comédie romantique, au sens qu’on donne en Occident à ce genre cinématographique. S’inscrivant dans un contexte réaliste, le film offre en outre au spectateur de l’Ouest un instantané très instructif sur la vie des classes moyennes moscovites de la fin des années 1970 et surtout sur le monde du travail dans les services de l’État. Un univers caractérisé par un certain dilettantisme, les grands bureaux apparaissant davantage comme des lieux de vie et de sociabilité que comme de véritables unités productives. Une façon de relativiser les grandes déclarations d’intention des politiques soviétiques de l’époque, mais également d’humaniser la réalité, somme toute assez conviviale, qui se cache derrière les plans quinquennaux.
Anatoli, père célibataire d’une quarantaine d’années, travaille au service des statistiques de Moscou, partageant ses joies et ses peines avec sa collègue et meilleure amie Olga. Lorsqu’il est amené à présenter sa situation familiale il emploie toujours la même formule, qui devient un des gimmicks comiques du film : « J’ai deux enfants : un garçon et… un autre garçon. » Toujours un peu serré financièrement, il espère avoir une promotion mais est peu apprécié de sa supérieure, Kalugina, une femme extrêmement froide et austère. Entre alors en scène Yuri, le nouvel adjoint de Kalugina, un cadre qui revient d’un stage en Suisse et qui se trouve être un ami de jeunesse d’Anatoli ainsi que l’ancien amant d’Olga. Yuri organise une réception chez lui pour fêter son retour en Russie et y invite tous ses collègues. Lors de cette réception il conseille à Anatoli de sympathiser avec Kalugina, et même si nécessaire de tenter de la séduire afin d’obtenir le poste qu’il convoite. Anatoli s’y essaie à contrecœur mais il est très maladroit et ne parvient qu’à se ridiculiser aux yeux de sa supérieure qui le supporte de moins en moins et devient de plus en plus cassante à mesure qu’il l’importune. Face à l’échec de toutes ses tentatives, l’employé se met en colère et l’insulte vertement, s’en prenant à son insensibilité et à son caractère tyrannique. Le lendemain, de retour au bureau, il va s’excuser auprès d’elle, craignant d’être licencié à cause de son inconduite. Kalugina a en effet été offensée mais également très déstabilisée par ce qu’il lui a dit. On découvre peu à peu que derrière la dame de fer se cache une solitude qui n’est pas forcément choisie et une femme blessée, humiliée d’avoir été ainsi percée à jour. La voyant si chamboulée, Anatoli essaie de la consoler : « Mais non, vous êtes démocratique… » lui dit-il, revenant sur ses reproches de la veille. Compliment incongru en la sincérité duquel elle ne croit pas un instant.
Romance de bureau offre une belle galerie de personnages secondaires, parmi lesquels le chef du service de nutrition publique, un homme obèse dont le bureau est face à l’escalier et qui ne peut s’empêcher d’observer les jambes des femmes qui montent devant lui, ou la responsable du personnel, qui semble ne jamais travailler et passe son temps à quémander une obole à ses collègues à l’occasion des naissances, des mariages, des anniversaires ou des enterrements des uns ou des autres. Il semblerait d’ailleurs qu’on s’active assez peu dans les services de l’État soviétique de cette période-là. Une des premières scènes nous montre l’arrivée des employés, qu’on nous présente en voix off et qui se serrent dans les transports publics, marchant à pas pressés dans les rues et se hâtant vers leur travail. Mais, une fois assises à leur bureau, toutes les femmes n’ont rien de plus urgent à faire que de sortir leur miroir et de se maquiller longuement : le travail attendra. En dehors de la sérieuse et consciencieuse Kalugina, les employés n’hésitent jamais à paresser et à palabrer, et quant aux esclandres et aux problèmes de discipline ils paraissent fréquents et ne scandalisent pas outre mesure, ce qui laisse à penser que lorsqu’on est fonctionnaire dans l’administration moscovite en 1977, on ne licencie pas facilement... « Je pense que sans les statistiques il n’y a pas de vie » affirme Anatoli à sa supérieure pour la convaincre de son dévouement bureaucratique – mais elle n’est pas dupe de cette profession de foi farfelue.
Leur relation va évoluer au fil des semaines, Anatoli gagnant en assurance tandis que Kalugina – à mesure que grandit entre eux une certaine attraction réciproque – se féminise et, dans le même mouvement, s’humanise. Une scène nous la montre surprenant Anatoli qui, croyant être seul dans le bureau de sa supérieure, s’est assis à sa place et s’amuse à l’imiter. Plutôt que de le réprimander de façon autoritaire, elle entre dans son jeu et essaie de le ridiculiser à son tour en l’imitant lui. Cette petite joute d’inversion des rôles contribue à briser la glace entre eux et à les faire évoluer. Et c’est à partir de là qu’Alissa Freindlich, l’actrice qui incarne Kalugina, démontre tout son talent. Le début du film nous présentait une femme presque androgyne, aux traits durs et sans grâce, mal fagotée dans des costumes surannés, sans aucune libido apparente, sans âge – on apprend plus tard qu’elle a 35 ans mais on pourrait lui en donner davantage et d’ailleurs, dans le bureau, tout le monde la surnomme « la vieille ». Mais le soir où elle invite Anatoli chez elle pour dîner, elle le reçoit royalement dans son petit appartement (décoré d’une reproduction de Modigliani), lui préparant un repas somptueux et arborant, pour la première fois du film, une robe élégante. Peu à peu on découvre une femme qui avait jusqu’ici caché sa beauté, une femme sensuelle au regard félin mis en valeur par son mascara, qui sait joliment s’habiller et qui est capable de troquer sa mine autoritaire contre des expressions de douceur, de fragilité et même de séduction. Pour opérer cette mutation elle demande conseil à sa secrétaire, une employée aussi coquette que tire-au-flanc qui se pique de se vêtir à l’occidentale. Lorsqu’elle lui recommande de porter un blaser, elle lui explique que c’est quelque chose qui se porte en club. « Un club ? lui demande Kalugina, dubitative. Comme la Maison de la culture par exemple ? » Mais au-delà de la tenue, de la coiffure et du maquillage, c’est réellement son regard qui change, au sens propre comme au figuré, ainsi que toutes ses attitudes corporelles. Elle d’habitude laborieuse et disciplinée, on la voit alors, bavardant avec sa secrétaire, s’étirer comme une chatte en soupirant « Oh je n’ai pas envie d’aller travailler… Mon Dieu, comme je n’ai pas envie… » L’amour l’a réellement métamorphosée.
En parallèle de cette romance s’en déroule une autre, plus malheureuse, celle qui pousse Olga vers son ancien amant Yuri. Celui-ci ne souhaite pas renouer ce lien du passé et tous deux sont par ailleurs mariés chacun de leur côté. Désespérée, Olga ne cesse de lui écrire des lettres qui demeurent sans réponse. Excédé, Yuri livre ces lettres à la responsable du personnel, qui fait rapidement fuiter l’affaire. « Retournez à votre famille, au collectif, au travail ! » conseille-t-elle à Olga un jour où elle la rencontre au marché, achevant de la démoraliser. Humiliée par le comportement indélicat de Yuri, elle finit par se résigner à l’impossibilité de cet amour. Apprenant cette muflerie commise par son ami, Anatoli le giflera, prenant la défense d’Olga. Yuri est un personnage ambivalent puisqu’il est d’abord présenté sous un jour positif (le cadre supérieur qui n’a pas oublié ses amis de jeunesse, qui continue de les traiter sur un pied d’égalité et qui intercède même en leur faveur auprès de la direction) puis sous un jour beaucoup plus négatif (il humilie gratuitement Olga puis, ayant été souffleté par Anatoli, tente d’empêcher son avancement et de saboter sa relation avec Kalugina). Il n’est pas non plus dénué d’une certaine charge comique car il incarne dans le film le rôle du petit-bourgeois soviétique fasciné par l’Occident et qui tire quelque prestige du fait d’y avoir vécu un moment. Il exhibe sa réussite à travers divers marqueurs de son occidentalisation : il a installé un mobile décoratif dans son salon car c’est ce qui se fait en Europe, il offre du fromage suisse à ses convives et distribue généreusement à ses subordonnées des paquets de Marlboro et des plaques de chocolat suisse. Il possède en outre une Volga avec lecteur cassettes qu’il montre fièrement à Anatoli, lequel s’exclame : « Mais c’est un petit appartement ! » Son séjour à l’étranger suscite aussi des interrogations plus surprenantes, comme celle de cette collègue de bureau qui lui demande s’il a assisté en Suisse à des spectacles de strip-tease… Il n’est peut-être pas innocent, sur le plan de la morale soviétique, que de ces deux histoires d’amour, celle unissant deux célibataires connaisse un happy end tandis qu’entre les deux personnes mariées elle se termine amèrement.
Le flirt entre les deux héros est pourtant loin d’être une idylle tranquille et ils vont passer par diverses étapes de crise et de réconciliation avant de s’affirmer comme couple. On comprend lors du repas chez Kalugina que cette dernière a peur de s’engager suite à une expérience malheureuse qu’elle a vécue dans le passé. « Un homme venait me voir et après… il s’est mariée avec mon amie » confie-t-elle à Anatoli. « Mais moi je n’ai pas l’intention d’épouser votre amie » lui répond-il pour la tranquilliser. « Et vous ne le pourriez pas : je me suis débarrassée de toutes mes amies » réplique-t-elle. Romance de bureau est plein de ces réparties cinglantes, qui contribuent beaucoup à l’attrait du film. Induite en erreur par Yuri qui conspire désormais contre son ami, Kalugina soupçonne Anatoli de l’avoir séduite uniquement pour obtenir une promotion. Il peine alors à lui faire comprendre que si c’était effectivement son intention à l’origine, il est réellement tombé amoureux d’elle par la suite. Ne sachant plus si elle doit le croire ou non, elle lui annonce leur rupture en même temps que sa promotion au poste qu’il convoitait. Offensé, Anatoli refuse le poste qu’elle lui offre et signe sa lettre de démission, qu’elle déchire aussitôt. Ils en viennent aux mains et s’envoient des projectiles à travers le bureau avant de se pourchasser dans tout le bâtiment, de sauter dans un taxi et… de tomber dans les bras l’un de l’autre. Cette réconciliation dans la violence, exaltation de la passion sous des formes détournées, clôt le film et fait de Romance de bureau un classique qui ne cesse, année après année, d’être rediffusé régulièrement à la télévision russe.
Écouter la chanson-titre du film